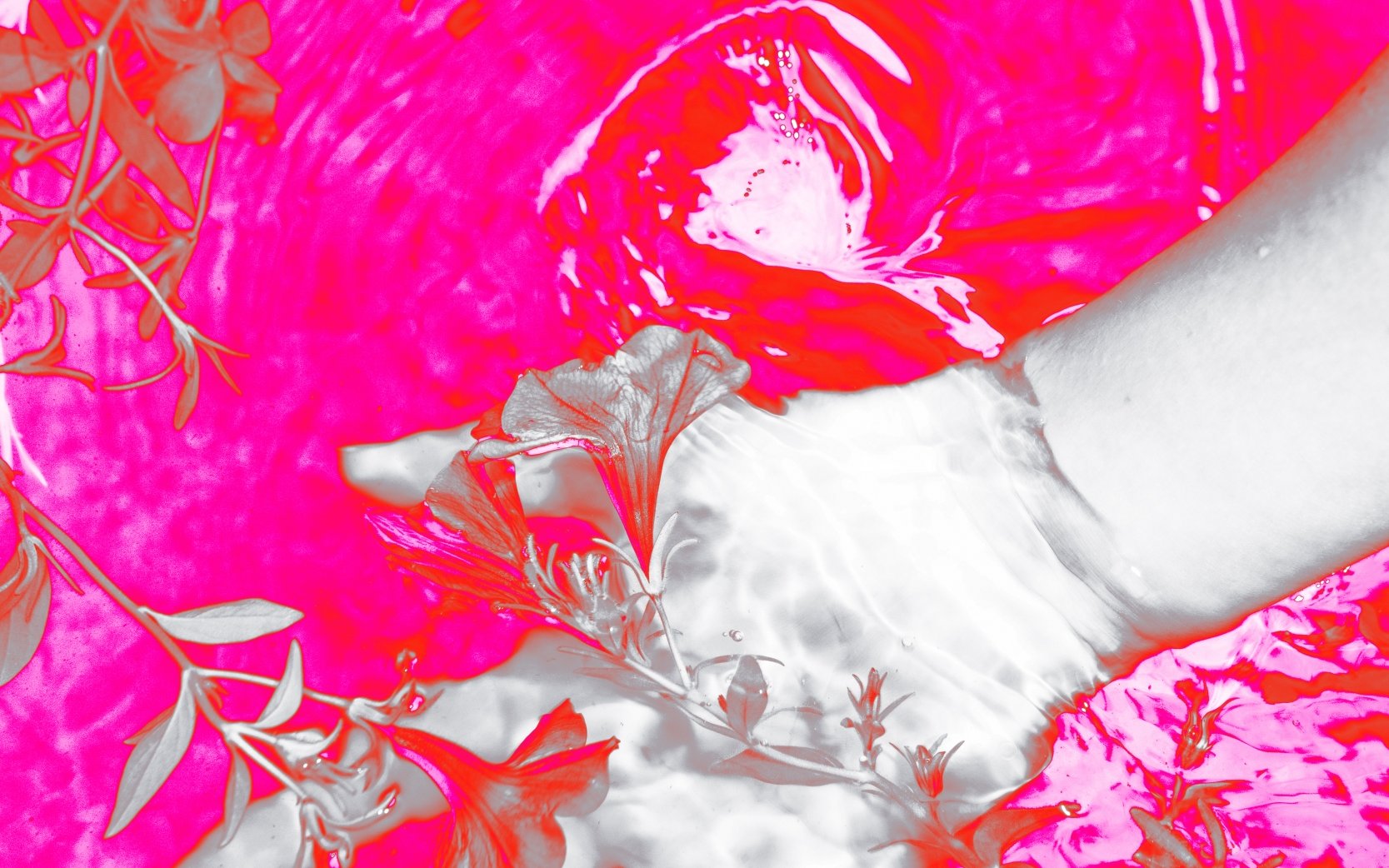
Musique et danse : deux exemples d’écosystèmes en symbiose - Interview par Guillaume Kosmicki
Les spectacles Devenir imperceptible et Dead trees give no shelter reposent tous les deux sur un dispositif scénique à la forte identité symbolique, qui s’agence en lieu de rencontre entre la musique et la danse. Chaque proposition est inspirée par un texte charismatique, un chapitre de Mille plateaux de Felix Guattari et Gilles Deleuze, The Waste Land de T.S. Eliot. Nous interrogeons dans cet article les rapports qui se tissent entre danse, musique et au-delà (installation, plateau, lumières...), au travers des interviews des protagonistes : le metteur-en-scène Clément Vercelletto et la danseureuse Pau Simon pour la compagnie Les Sciences Naturelles ; la chorégraphe Soa Ratsifandrihana et Florentin Ginot, directeur artistique de la compagnie HowNow.
Devenir imperceptible
Guillaume kosmicki : Pouvez-vous décrire le dispositif du spectacle ?
Clément Vercelletto : Il y a plusieurs éléments principaux : Pau Simon dansant sur scène ; une scénographie de Bastien Mignot, réappropriation de la pièce La Tèrra es un astre (« La Terre est une étoile ») ; une lutherie hybride que j’ai commandée et cofabriquée avec le luthier Léo Maurel, nommée « l’engoulevent » ; un dispositif de sonorisation du corps de l’interprète (capteurs piézoélectriques sur les chevilles) ; un dispositif lumière de Florian Leduc.
Pau Simon : Selon moi, c’est un paysage d’organes liés à la fonction de l’air : j’y projette des poumons, et même un cœur, avec le moteur de la machine de l’engoulevent. Dès la deuxième répétition, tout ce dispositif était présent. Un grand potentiel d’imaginaires y est contenu en puissance, à la fois musical et plastique. Il constitue mon environnement de travail et de jeu, mon habitat. C’est donc à partir de lui que j’ai fait des propositions au plateau.
G.K. : Qu’est-ce qui relie tous ces éléments ?
P.S. : C’est justement la dimension de l’air qui relie les éléments entre eux, sa circulation dans différents corps. C’est aussi la dynamique constante des relations son-lumière-danse-espace, qui font paysage ensemble.
G.K. : Quelle a été la place de Pau Simon dans la conception du spectacle ?
C.V. : J’avais travaillé dans un précédent spectacle, La mélodie des choses, avec un dispositif de micros piézo placés sur les chevilles de Bastien Mignot, avec qui je dirige la troupe Les Sciences Naturelles. C’est lui qui était sur scène. On a eu l’idée d’en tirer un solo. Beaucoup d’autres éléments existaient avant ma rencontre avec Pau, comme la scénographie, ou l’idée de l’instrument à vent.
P.S. : Nous nous sommes rencontrés sur une pièce de Julien Desprez, où tout le monde dansait et jouait. Clément, je crois, avait vu alors mon bestiaire intérieur. Je pense que nous nous comprenions assez bien sur les questions d’invisible, de minimalisme, et dans ce que je pressentais d’un désir de radicalité. On s’est lancés. Après La mélodie des choses avait surgit pour lui l’imaginaire de l’oiseau, en parallèle de la construction de l’instrument-oiseau, l’engoulevent. Il m’a parlé de ses souvenirs d’enfant, fasciné par la présence de ces animaux, leurs jeux et leurs constructions, avec une attention particulière pour leurs prouesses sonores. J’ai commencé à chercher des oiseaux en moi.
C.V. : Comme c’est un solo, c’est avec Pau que j’ai écrit le spectacle, en relation rapprochée et en grande connivence. Il s’est construit sous la forme d’une écriture de plateau. Je lui ai demandé d’improviser, mais aussi de me faire confiance sur certains passages, que je lui ai demandé de fixer. Iel est par exemple parfois dans la quasi-immobilité.
G.K. : Et quelle est sa place dans le spectacle ?
C.V. : Une question est posée au fil de son évolution : comment est-iel humain·e, ou animal·e ? Sans entrer dans l’anthropomorphisme ou dans l’imitation pure, nous jouons sur cette interrogation. Sur la première partie, on voit peu l’interprète, on découvre un corps dans la pénombre. Nous avons imaginé ça comme une aurore, un lever de soleil, un réveil. L’engoulevent se met en marche lentement. Dans un second temps, on découvre la scénographie, le personnage, on commence à voir son visage, son corps. Les micros piézo sur les chevilles de Pau interviennent à ce moment, comme une explosion. Ce sont des micros contacts, qui captent les vibrations de la surface sur laquelle ils sont plaqués. Ils aménagent un effet de surprise, un peu magique, lorsqu’ils apparaissent. Les sons sont traités, mais pas tellement transformés, juste filtrés. Ces sons bruts de frottements contre la peau, ou de craquements des genoux, sont très noise (bruitistes), suramplifiés et proches du larsen. Ils ne sont qu’un élément dans le dispositif. En plus de ces sons produits par Pau, j’en ajoute d’autres. C’est un jeu sur le trouble, qui fait l’essence du spectacle.
G.K. : Quels sont les rapports entre la danse et la musique ? P.S. : Ils sont multiples et mouvants, et forment des boucles de circulation. À certains moments de la pièce, la danse peut être autonome par rapport à la musique. À d’autres moments, le son produit par l’engoulevent va générer une qualité de corps. Parfois je produis mon propre paysage sonore, mais Clément interfère en direct sur la nature du son, ce qui induit encore de nouvelles qualités. Ce sont des jeux de boucles et d’écoute infinis. En ce sens, cette pièce n’est pas totalement écrite, mais je dirais plutôt qu’elle écrit les rapports.
C.V. : Toute une partie musicale avec l’engoulevent a été conçue indépendamment de la danse, mais la section avec les micros piézo est vraiment travaillée en aller-retour, nous avons co-écrit ces improvisations. Il y a un terme utilisé entre danseurs : la « musicalité ». Ils se comprennent très bien lorsqu’ils en parlent. J’ai fini par le comprendre à mon tour : c’est comme imaginer une représentation musicale du corps. C’est ce qui s’opère ici. Pau souffle aussi dans mes appeaux. Pour le public, c’est un jeu sur qui déclenche qui, entre Pau et la musique. Est-ce joué en temps réel ? Est-ce synchronisé ? Est-ce une bande son ? Ce sont aussi des questions pour Pau, car je lui demande d’être très attentif·ve au sonore.
G.K. : Pau, je sais par ailleurs que le rapport à la musique est fondamental pour toi, et que tu recherches généralement cette porosité de la frontière entre la danse et l’art musical.
P.S. : Le fait d’avoir grandi avec une sœur pianiste m’a permis de nouer un lien fort avec la musique sans que j’aie à l’intellectualiser. Je me suis toujours senti·e dans l’entre-deux, comme un·e musicien·ne infiltré·e dans la danse, ou un·e danseureuse infiltré·e dans la musique. Par ailleurs, les approches expérimentales du sonore et la dimension du live m’intéressent beaucoup. Je n’ai pas beaucoup de plaisir en travaillant avec des bandes sons. Je préfère traverser une chose qui s’expose fort au présent et aux présences, entre autres dans la relation avec des musicien·nes. La façon de travailler de Clément me parle beaucoup en ce sens, dans cette exploration en live à partir d’un cadre commun.
G.K. : Quelle est la part de concret, de narration, d’incarnation et d’abstraction entre tous les médiums ?
C.V. : Je ne peux pas le quantifier. L’abstraction est ce qui me touche le plus, avec l’absurde et le rêve. J’essaye de ne jamais fermer. En écrivant la pièce, j’ai des intuitions, mais je ne saurais pas comment parler de ce qu’elle dit. Je laisse les choses le plus ouvertes possibles. Certains endroits me touchent dans le spectacle justement parce que je ne sais pas exactement ce qui s’y joue. Il y a aussi beaucoup d’étrangeté, c’est un jeu sur la réalité.
G.K. : Et dans la danse ?
C.V. : Le corps de Pau est assez multiple. Il n’y a pas d’imitation à proprement parler. Nous nommons par exemple une de nos séquences « l’araignée », mais on n’y voit pas une araignée à huit pattes, elle l’incarne sans imitation particulière. Il y a un rapport à la terre, plusieurs autres animaux sont imaginables, mais cela reste assez rêvé, ce n’est pas du tout naturaliste.
P.S. : Il y a des enjeux de plasticité et de métamorphose. J’ai l’impression de glisser (ou de tomber) dans des corps en perpétuelle mutation, ou bien d’un geste musical vers un geste narratif, d’un corps graphique vers un corps paysage. Je suis chimère ancienne à flûte, rapace nocturne, paysage, araignée pétrifiée, je suis son, je suis jardinier, je suis résonance de l’espace, je suis aussi de l’absence. Ces fictions sont une science fragile, mais j’y travaille avec sincérité. Elles restent ouvertes. Devenir imperceptible propose justement une réflexion sur la perception et tout ce qu’on voit de l’invisible, tout ce que l’on entend dans l’inaudible. Nous travaillons dans cet oxymore, une présence sur scène qui orchestre également sa disparition. Si le titre est très référencé, et peut être chargé pour qui a lu Deleuze et Guattari, je le prends personnellement comme un mantra poétique, adressé peut-être au devenir incertain du chant des oiseaux, à un devenir-sensible.
G.K. : Justement, Clément, peux-tu en dire plus sur ce titre ?
C.V. : Cela vient du gros pavé Mille plateaux, de Gilles Deleuze et Félix Guattari. C’est une sorte de Bible dans laquelle je reviens régulièrement me plonger. Cinq ans plus tard, on peut comprendre soudainement un passage qu’on avait trouvé illisible. Il y a un balancement constant entre des moments très poétiques, faciles à lire, et d’autres incompréhensibles, très ampoulés. Un des chapitres s’intitule « Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible ». Cette notion du devenir m’a paru très intéressante. Il prend l’exemple de la tarentelle en Italie, où l’interprète de la danse devient l’araignée. Ce qui est imperceptible devient quelque chose, donné à voir, à sentir, à entendre. Voir disparaître l’humain. Donner à entendre l’intérieur du corps. C’est la base de ma réflexion.
Dead trees give no shelter
Guillaume Kosmicki : Pouvez-vous me présenter le spectacle ?
Florentin Ginot : Le spectacle devait s’intituler The Waste Land, tirant son origine du poème de T.S. Eliot. Il s’agit pour moi d’un texte impossible à mettre en scène par sa richesse, son absurdité, son éclatement temporel et iconologique. En revanche, il nous permet d’en extraire certains personnages comme Tirésias, la sybille, etc., et de là certaines qualités corporelles pour les danseurs. J’ai envie de faire vivre ces corps dans ce Waste Land. Dans mes spectacles, je souhaite avant tout faire ressortir une expérience pour le public plutôt qu’un sens. Les gens vont se retrouver devant un monument imposant, une grande structure scénique avec une forte qualité écrasante, qui sera traitée en lumière. Elle repose sur le modèle du caldarium de Pompéi. Peu à peu, comme T.S. Eliot parle beaucoup de souffrance humaine dans son poème (personnages aveugles, émasculés, violés, etc.), je veux utiliser ces souffrances en termes de qualités corporelles pour la danse et en sortir via l’énergie projetée par des éléments de transe, observer une trajectoire humaine qui amène à une délivrance.
Soa Ratsifandrihana : Dead trees give no shelter est un patchwork de différents arts : la musique, la danse, le travail de la lumière, de la dramaturgie et de la scénographie. Nous devons trouver la bonne balance entre ces différents médiums pour les faire communiquer ensemble, évoluer, se répondre et s’écarter. C’est un peu de la cuisine. Au cours de mes différentes lectures du poème The Waste Land, j’ai pu constater qu’il y avait une polyphonie entre les personnages, soit mythologiques, soit figures ordinaires de l’entre-deux-guerres. Je souhaite l’intégrer dans l’écriture chorégraphique : juxtaposer des esthétiques ou des voix différentes qui se confondent, se font écho et participent à l’évolution de l’énergie de la danse et de la pièce. Je suis une danseuse contemporaine, c’est ma formation et c’est ma manière de penser la chorégraphie. Je possède aussi des influences hip-hop. Germain Zambi est un krumper pure souche, Ingrid Estarque évolue entre deux esthétiques, la danse contemporaine et le krump. Cette composition à trois danseurs est donc un mélange qui convoque différentes esthétiques.
F.G. : La danse va être très importante sur la notion de révolte humaine. Le krump est une danse de rue, de gangs, de battle. Ça va probablement être violent, tellurique. Ingrid Estarque m’a expliqué que cette danse amène à une forme de modification de l’état de conscience par l’expulsion, quand les danses de thérapie se focalisent sur l’introspection et la transe.
S.R. : Le krump vient de Los Angeles où il est né dans les années 2000. Il possède son vocabulaire. On s’y crée un personnage, dans une physicalité très prononcée, qui entre en dialogue avec l’autre.
G.K. : Florentin, peux-tu décrire ce caldarium ?
F.G. : Je suis tombé sur cette image au moment où je travaillais le concept avec le dramaturge Michel Böter et le musicien Helge Sten. Lors de nos échanges avec le scénographe Olivier Defrocourt, nous en avons tiré cette architecture imposante de 6,40 m x 5 m. La notion de monumentalité est très importante dans ce spectacle, y compris en matière de son et d’expérience sensorielle. La structure s’agence aussi comme un élément important de dramaturgie, parce que ses murs se démantèlent peu à peu. Ce monument représente The Waste Land. Les trois danseurs s’y trouvent dans un ovale de trois mètres de profondeur pour trois mètres d’ouverture, qui enlève toutes les notions de course et de travail au sol et écrase les corps. La qualité principale du caldarium est l’espace réduit, l’enfermement des danseurs et sa capacité d’ouverture au moment où les murs s’arrachent progressivement. Le but était de travailler sur la contrainte extrême des corps dans cet espace. Nous en tirons une performance sur l’idée d’une révolte humaine, qui passe par le mouvement et par la puissance sonore électronique d’Helge Sten, pour en dégager une forme d’expérience vibratoire, visuelle et sonore pour le public, dans la symbiose avec les corps. J’aimerais qu’on parvienne à un stade supérieur de performance où les corps des danseurs et les corps des musiciens soient dans une énergie qui happe les frontières. J’avais prévu au début jusqu’à cinq caldariums. Le fait de n’avoir plus qu’une structure permet également de faire vivre l’espace autour. Helge a sa propre station sur un cube, qui est aussi un objet scénographique. Je serai pour ma part aussi en dehors de la structure avec ma contrebasse.
G.K. : Quelle est la place de la danse et de la chorégraphie dans le spectacle ?
S.R. : Ce qui m’intéresse est la manière dont la danse peut imposer sa temporalité au sein d’un spectacle, qu’elle ne soit pas juste illustratrice de ce qu’on entend et de ce qu’on voit, qu’elle puisse aussi annoncer la musique ou annoncer la lumière. La question est aussi de savoir comment créer une danse libre et grande dans les contraintes de l’espace clos et restreint de l’architecture du Waste Land.
F.G. : J’ai des idées très claires sur ce que j’attends du spectacle, mais Soa est la chorégraphe, Michel est le scénographe, et il est important de respecter la contribution artistique de chaque protagoniste (les anglais parlent du respect de l’« authorship »). C’est une balance. Nous parlons beaucoup avec Soa de processus de transformation, de projection vers le public et d’énergie. Elle se charge ensuite de la réalisation en mouvements, avec ses interprètes. Je guide en termes de structures. On place des jalons, elle me dit ce qui est réalisable ou non selon les temporalités.
G.K. : La musique d’Helge Sten s’appuie sur un continuum avec peu d’événements, une évolution lente, une montée progressive vers un climax, sans rupture. Soa, je suppose que la danse est très libre dans un tel cadre musical ?
S.R. : Oui, absolument. Pour la danse comme pour la lumière, il s’agit d’un exercice de contrepoint, comme si chaque art suivait un rail : il nous faut examiner comment ces rails peuvent se coordonner, résonner entre eux mais aussi se séparer, créer des ruptures, des événements qui participent au continuum. La musique d’Helge fonctionne sur des nappes sonores très denses et puissantes qui peuvent paraître écrasantes. Je travaille sur la façon dont la danse peut créer une forme de légèreté et surtout une forme de rythmicité, une pulsation, un jeu habile avec la musique. Florentin m’a envoyé plusieurs séquences musicales, que la danse ne suivra pas forcément, car elle suit sa propre évolution, son propre continuum, avec des ruptures physiques, des changements d’effectifs (un, deux ou trois danseurs). Elle n’est pas en miroir avec la musique d’Helge, et peut même être parfois en contradiction avec ce qu’on entend.
G.K. : Florentin, qu’est-ce qui explique selon toi le besoin des gens à aller aujourd’hui vers ce type de spectacle, interdisciplinaire et immersif ?
F.G. : Je fais toujours des spectacles que j’aurais envie d’aller voir. C’est très simple comme point de départ, mais c’est important. Les spectacles qui m’ont le plus transporté ne sont pas forcément immersifs mais ils possèdent une intensité de performance extrême. Ce qui m’intéresse est de faire vibrer l’espace, que le public soit plongé dans quelque chose qui vibre avec lui, autour de lui, quelque chose de total. La musique contemporaine est restée trop longtemps dans son coin, sans ambition de révolutionner les genres, alors que la danse contemporaine et le cirque exploraient énormément les alentours. Il est temps ! On se posait trop de questions avant. Aujourd’hui, tout un jeune public de l’entre-deux est prêt à ces expériences, une nouvelle forme intermédiaire qui accomplirait la gageure de relier une prestation avec son et lumière de David Guetta à un concert de Boulez par l’Ensemble intercontemporain, sans être ni l’un ni l’autre. Nous nous produisons pour le Grame dans la verrière des SUBS, un espace énorme. Il faut que les gens s’en emparent par leurs mouvements, leurs déambulations autour du spectacle, cela participe de l’expérience de Dead trees. Nous le proposerons en version frontale par la suite. C’est uniquement pour la B!ME qu’on va avoir cette expérience pleinement immersive.